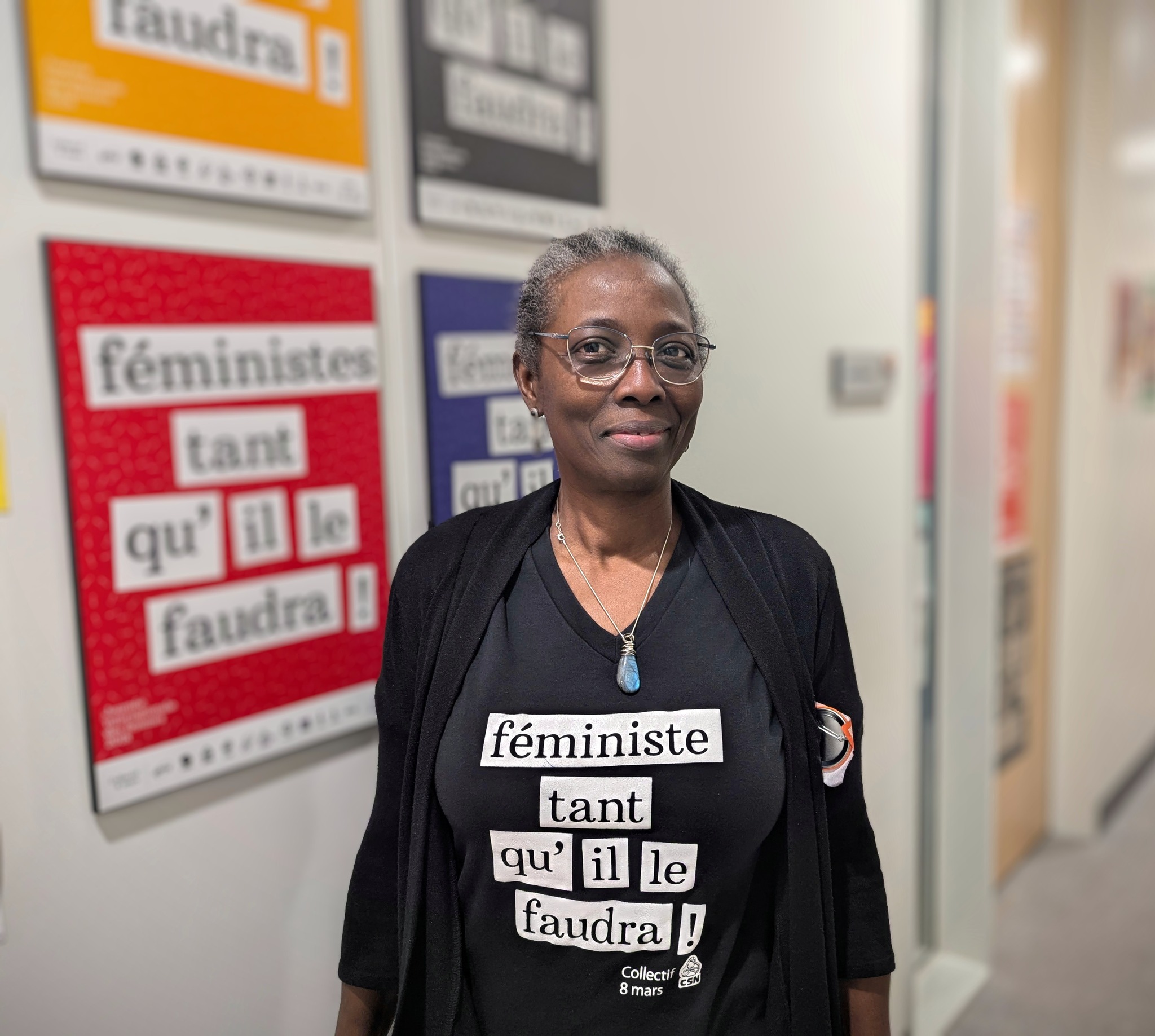À propos
Le conseil central du Montréal métropolitain–CSN (CCMM–CSN) rassemble tous les syndicats de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d’Eeyou Istchee Baie-James. Il compte près de 400 syndicats représentant plus de 110 000 membres œuvrant dans tous les secteurs d’activités, tels que la construction, la santé et les services sociaux, les communications, l’industrie manufacturière, les services publics et parapublics, l’éducation, le commerce, etc.

Mission
Le CCMM–CSN a pour but de promouvoir les intérêts professionnels, économiques, sociaux, politiques et culturels des membres de ses syndicats affiliés de même que des personnes les plus marginalisées de notre société. Il appuie les syndicats affiliés dans la négociation de leurs conditions de travail, il développe la solidarité entre eux, organise diverses campagnes d’ordre syndical ou social, met en place des programmes de formation adaptés aux besoins spécifiques de ses membres, travaille en collaboration et en coalition avec les autres acteurs régionaux et intervient auprès des pouvoirs publics afin de faire avancer ses valeurs et ses positions politiques.
Le conseil central assume également une responsabilité de représentation politique en siégeant à diverses instances ayant une incidence économique, politique ou sociale.

Valeurs
Le Conseil central du Montréal métropolitain–CSN lutte contre toutes les formes d’exploitation et milite en faveur d’un projet de société fondé sur la démocratie, les droits de la personne, la protection de l’environnement et la transition juste, la justice sociale, l’égalité et l’équité. Pour ce faire, plusieurs fronts de lutte s’activent en son sein.

Notre action sur les deux «fronts»
L’action du CCMM-CSN s’exerce sur différents plans, que l’on résume traditionnellement à deux « fronts ». Le premier concerne l’action syndicale à proprement parler, soit la lutte pour de meilleures conditions de travail et de salaire, qui passe entre autres par la mobilisation et la formation afin d’accroitre le rapport de force des travailleuses et travailleurs. Le deuxième front désigne la lutte sociopolitique menée sur des enjeux plus globaux, tels l’environnement, la condition féminine, l’éducation, etc. Bien sûr, cette distinction entre les deux fronts, qui remonte à la présidence de Marcel Pepin à la CSN durant les années 1960, n’est pas coupé au couteau. Pensons par exemple au secteur public: les revendications des syndicats en matière de conditions de travail, donc du premier front, sont pour l’ensemble de la population une lutte de deuxième front pour l’amélioration des services publics. En fait, pour le CCMM-CSN, l’action syndicale est indissociable de l’action politique : c’est de cette manière intégrée qu’il conçoit son travail et qu’il l’organise.
Le travail du CCMM-CSN
Un élément clé de l’action du Conseil central est l’appui aux syndicats en lutte, que ce soit lors du renouvellement ou en cours de convention lors d’une mobilisation. À la CSN, le travail des conseils centraux concerne l’analyse stratégique, la mobilisation et l’organisation de la grève. La négociation et les aspects juridiques d’un conflit étant davantage du ressort de la fédération à laquelle le syndicat est affilié (lien). Les personnes conseillères syndicales affectées au conseil central (lien) proviennent majoritairement du Service d’appui aux mobilisations et la vie régionale de la CSN (SAMVR) (Lien) et sont soutenus dans leur travail par des employé-es de bureau (lien). Leur rôle principal est d’appuyer les syndicats afin d’augmenter leur rapport de force pendant leurs négociations, de structurer leurs réseaux de communications, et si nécessaire, de les conseiller sur la manière stratégique de mener leur conflit.
La formation représente l’un des aspects essentiels du travail du Conseil central. Elle vise l’organisation du syndicat lui-même, afin de permettre aux élu-es et délégué-es syndicaux de disposer de toutes les compétences et connaissances nécessaires à leur fonction. Il y a également de la formation sur les enjeux politiques. Cela permet aux membres des syndicats d’avoir accès à des connaissances et analyses qui donnent du sens à leur action et les incitent à se mobiliser politiquement. Des dizaines de personnes formatrices issues des syndicats partagent leur expérience et leurs connaissances de manière à renforcer l’ensemble des syndicats de la région et leur permettre ainsi de défendre les intérêts de leurs membres.
Par-delà le premier front, une part importante du travail effectué par le Conseil central, en particulier par ses élu-es et ses comités, concerne l’action politique régionale. Seul ou en coalition avec des groupes alliés, le CCMM-CSN intervient publiquement sur des enjeux sociaux, politiques, économiques, environnementaux, démocratiques, afin de faire entendre sa voix et faire valoir ses principes. Ces interventions prennent différentes formes : déclarations, conférences de presse, manifestations et actions de mobilisation, participation à des forums régionaux, présence sur des conseils d’administration, etc.
Cette action politique s’inscrit aussi dans le cadre des débats internes de la CSN, où le Conseil central intervient fréquemment lors des instances pour influencer les positions confédérales. Les intérêts et positions politiques des organisations affiliées à la CSN n’étant pas toutes identiques, ces interventions peuvent par moment soulever d’intenses débats. Ces échanges, notamment lors des réunions du conseil confédéral de la CSN, contribuent à faire avancer les positions de la confédération sur différents dossiers, ce qui est particulièrement le cas ces dernières années en ce qui concerne l’environnement et le libre-échange.
Le travail d’action et d’éducation politique du CCMM-CSN se poursuit également par l’entremise des comités des fronts de lutte, qui abordent une multitude de questions sociopolitiques d’actualité.
Historique
Le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM–CSN) reconnu comme l’une des organisations plus combatives du milieu syndical, est riche d’une histoire de luttes syndicales, sociales et politiques qui la placent au cœur de l’histoire syndicale du Québec.
L’ancêtre de l’actuel CCMM-CSN est le Conseil central des syndicats catholiques nationaux de Montréal (CCSNM). Il a été fondé le 20 février 1920 par les délégués de six syndicats : le Syndicat des employés de magasin, l’Union des travailleurs de la chaussure, le Syndicat de Dupuis et Frères, le Semi-Ready Tailoring, le Syndicat des plombiers et le Syndicat des menuisiers. Leur volonté était d’outiller les travailleuses et travailleurs sur le plan syndical et politique. Près d’un an plus tard, on dénombre déjà 23 syndicats au CCSNM.
Le 24 septembre 1921, le conseil central participe, avec les délégués des conseils centraux de Hull, de Québec et de Granby, à la fondation de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC), qui deviendra, en 1960, la Confédération des syndicats nationaux (CSN). D’ailleurs avec le temps, le Conseil central prendra ses distances de l’Église. Alors qu’à ses débuts un aumônier jouait le rôle d’autorité morale dans les débats du CCSNM, l’organisation se détachera progressivement de l’influence cléricale jusqu’à se laïciser complètement à partir des années 1960.
Dès le départ, le CCSNM a appuyé la lutte des travailleuses et travailleurs pour l’amélioration de leurs conditions de travail, souvent pénibles au début du vingtième siècle. Il a pris part à de nombreuses grèves emblématiques qui ont laissé une trace dans l’imaginaire québécois: qu’on pense à celles des ouvriers du transport contre le One man car durant les années 1920, des ouvrières de la Dominion Textile en 1946, à la grève de l’Amiante à Asbestos en 1949, à celle de Murdochville huit ans plus tard, à la grève chez Dupuis Frères en 1952 ou à celle des réalisateurs de Radio-Canada en 1958. Il est à noter que quelques-uns de ces conflits se sont déroulés en dehors du territoire du Conseil central, ce qui ne l’a pas empêché de prêter main-forte aux travailleurs et travailleuses.Depuis un demi-siècle, le CCMM-CSN a adopté plus ouvertement une position de contestation des pouvoirs politiques qui ne se dément pas, et qui n’épargne aucun gouvernement, municipal, provincial ou fédéral. La lutte contre le duplessisme dans les années 1940 a été suivie de la résistance à la très réactionnaire administration Drapeau à Montréal durant les années 1960 et des affrontements avec le gouvernement fédéral dans le dossier des « gars de Lapalme », l’une des luttes les plus marquantes de l’histoire du Conseil central.
L’action au niveau municipal s’est concrétisée par une contribution importante à la mise sur pied du Front d’action politique (FRAP). N’eût été de l’adoption des mesures de guerre lors de la crise d’Octobre de 1970 et d’une campagne de propagande soutenue de la part des forces réactionnaires de la région, ce parti politique ouvrier semblait devoir connaître un certain succès électoral. Deux des candidats du FRAP aux élections de 1970 étaient d’ailleurs membres de l’exécutif du CCMM.
La création du Comité régional intersyndical de Montréal (CRIM) (ajouter lien vers X), à l’initiative du Conseil central mené par Michel Chartrand, illustre aussi cette volonté affichée de travailler en coalition avec les organisations alliées afin d’exercer une influence politique significative sur la politique montréalaise et régionale.
La condition féminine constitue aussi un front de lutte névralgique depuis des décennies où des avancées certaines ont été réalisées. La campagne pour les garderies publiques, qui remonte aux années 1970, en est un exemple frappant, la persévérance des militantes du comité du Conseil central ayant contribué à la création, 25 ans plus tard, du réseau des centres de la petite enfance. Depuis les années 1970, le conseil central a joué un rôle important en solidarité internationale. Il a ainsi été à l’origine d’importantes campagnes internationales d’appui au peuple chilien à la suite du coup d’État de 1973, ainsi qu’au peuple palestinien dans sa lutte contre l’oppression israélienne, dossiers qui continuent d’occuper le comité. Ce dernier est à l’origine de la Conférence internationale de solidarité ouvrière, en 1975, devenue par la suite le Centre international de solidarité ouvrière (CISO), une organisation toujours très active.
Historiquement, les comités des fronts de lutte ont joué un rôle non négligeable dans plusieurs dossiers sociaux d’importance. On peut entre autres penser au dynamisme des militantes et militants du comité LGBT+, appelé à l’époque le comité des gais et lesbiennes, dans la lutte pour la reconnaissance des conjoints puis du mariage entre personnes du même sexe durant les années 1990 et 2000. La défense des droits des personnes LGBT+ est un exemple éloquent de la manière dont l’action des fronts de lutte du CCMM-CSN peut exercer une influence profonde sur la CSN : alors que cette défense est maintenant un enjeu consensuel au niveau confédéral, ce sont initialement les délégué·e·s du CCMM-CSN qui ont porté cette cause et convaincu le congrès de la CSN de son importance.
Le comité de la condition féminine a aussi joué un rôle important dans l’organisation de la marche Du pain et des roses en 1995, devenue aujourd’hui la Marche mondiale des femmes.Au début des années 2000, notons la participation aux manifestations contre la Zone de libre-échange américaine lors du Sommet de Québec en 2001, où plus de 2000 militantes et militants des syndicats affiliés au CCMM-CSN se sont rendus à Québec pour manifester leur opposition à l’hégémonie néolibérale.
Plus récemment, ce sont les luttes pour la défense des services publics et contre l’austérité qui ont suscité les plus grandes mobilisations politiques au CCMM-CSN. Des campagnes régionales et nationales ont donné lieu à de nombreuses actions, des manifestations de masse aux occupations d’institutions financières. La journée du 1er mai 2015 a été particulièrement marquante à cet effet, alors que des manifestations et des actions ont été organisées partout sur l’île de Montréal durant toute la journée, certains syndicats allant jusqu’à adopter des mandats de grève politique.
Au cours des dernières années, des conflits de travail comme celui au Journal de Montréal en 2010, à l’Hôtel des Gouverneurs de la Place Dupuis et à la SAQ en 2016-2017 ainsi que dans les centres de la petite enfance en 2018, ou encore du front commun en 2023-2024 ont impliqué des centaines sinon des milliers de grévistes. Ceci illustre bien l’importance du travail effectué par le Conseil central du point de vue de la mobilisation, tant par son ampleur que par son intensité.
Dans les dernières années, le dossier de l’environnement s’est imposé. Le comité environnement a été très actif, notamment par une participation soutenue aux travaux du Front commun pour la transition énergétique et une contribution à l’organisation de diverses actions, dont la manifestation monstre du 27 septembre 2019.
À plusieurs égards, le Conseil central a joué au cours du dernier siècle le rôle de fer de lance dans des luttes ayant mené à des avancées en faveur de l’égalité des droits, de la justice sociale et de la démocratie pour l’ensemble de la population, syndiquée ou non.
Une chose est sûre: ce n’est que par l’unité, la solidarité et la mobilisation de l’ensemble des forces progressistes de la société que nous viendrons à bout des systèmes économiques et politiques qui se fondent sur l’exploitation des êtres humains et de la nature, les inégalités et l’injustice. En ce sens, le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN poursuivra ses luttes en solidarité avec toutes les organisations et les personnes qui souhaitent agir pour que notre société devienne plus juste, plus inclusive, plus démocratique et plus écologique!
- Alfred Charpentier (1920-1922) – Briqueteur
- Didace Pilon (1922-1926) – Carrossier
- Clovis Bernier (1926-1931)
- Alfred Charpentier (1931-1935)
- Philippe Girard (1935-1939) – Syndicat de la compagnie de tramway
- J.B. Delisle (1939-1942)
- Philippe Girard (1942-1943)
- G.A. Gagnon (1943-1947)
- H. Laverdure (1947-1961) – Briqueteur
- Gérard Picard (1961-1966) – Journaliste
- René Cadieux (1966)
- Dollard Généreux (1966-1968) – Électricien
- Michel Chartrand (1969-1978) – Imprimeur
- André Lauzon (1978-1980) – Travailleur à l’usine de papier Perkins
- Gérald Larose (1980-1983) – Organisateur communautaire
- Irène Ellenberger (1983-1985) – Conceptrice visuelle
- Pierre Paquette (1985-1991) – Enseignant
- Sylvio Gagnon (1991-1993) – Travailleur à la Canadian Gypsum
- Arthur Sandborn (1993-2006) – Organisateur communautaire
- Gaétan Châteauneuf (2007-2013) – Mécanicien à la Société de Transport de Montréal (STM)
- Dominique Daigneault (2013-2025) – Professeure de cégep en techniques de travail social
Structure démocratique
Le congrès est l’instance souveraine du conseil central. Tous les trois ans, les délégué-es des syndicats affiliés se réunissent pour définir les grandes orientations et les priorités du conseil central.
Consulter les documents du congrès 2025 – À venir bientôt
Les décisions concernant l’action du conseil central se prennent lors de l’assemblée générale mensuelle. C’est un lieu de réflexion démocratique et de solidarité pour les syndicats. Sauf en janvier, l’assemblée générale se tient le premier mercredi de chaque mois et fait relâche durant les mois de juillet et août.
Le conseil syndical
Composé des membres du comité exécutif, et des responsables des comités des fronts de lutte, le conseil syndical contribue au développement des orientations et des politiques générales du conseil central. Le conseil syndical soutient les luttes syndicales et sociales en s’appuyant sur la contribution des militantes et militants qui œuvrent au sein des comités des fronts de lutte. Les membres de l’équipe peuvent également participer, avec droit de parole, mais pas de vote.

Hardley Hippolyte
Responsable du comité immigration et relations interculturelles (CIRI)
Visiter la pageComité exécutif
Au quotidien, le conseil central est orienté et administré par un comité exécutif. Le comité exécutif est composé de cinq membres élus en congrès : la présidence, le secrétariat général, la trésorerie et deux vice-présidences. Il anime la vie syndicale et voit au développement ainsi qu’à l’articulation de ses grandes missions qui sont :
- La défense des droits et libertés;
- La promotion du droit à l’égalité;
- L’éducation politique et la formation au sein des syndicats;
- L’appui aux luttes syndicales et sociales;
- Les campagnes;
- L’action politique pour le progrès social;
- La lutte à la pauvreté.

Comités statutaires
Comité de mobilisation
Le Comité de mobilisation est fondamental pour faire vivre le conseil central, l’ancrer sur le terrain, et lui donner la force du syndicalisme de combat! Plus concrètement, il recommande et met en œuvre les moyens d’action favorisant l’atteinte des objectifs du CCMM-CSN. Il participe au choix des enjeux de mobilisation stratégique, il planifie, organise et participe à des événements, conçoit, prépare et diffuse les outils de mobilisation (affiches et tracts, par exemple), organise des tournées des membres, etc.
- D’appuyer la mise en œuvre des campagnes du conseil central et de la CSN et d’apporter un soutien aux luttes menées par les syndicats locaux en collaboration avec l’équipe du CCMM-CSN ;
- De coordonner le réseau de solidarité et le réseau de mobilisation fusionnés;
- D’appuyer l’organisation de mobilisations dans le cadre des plans d’action du conseil central, tout en considérant les diverses alliances;
- De favoriser la participation la plus large possible des syndicats aux mobilisations du conseil central;
- De participer aux actions du conseil central et de mobiliser pour celles-ci;
- De soumettre des propositions et de rendre compte des activités aux instances décisionnelles appropriées;
- D’un maximum de dix (10) militantes et militants provenant de syndicats représentant toutes les fédérations et qui seraient élus à la première assemblée générale suivant l’adoption des propositions du 36e congrès ;
- d’une (1) personne du comité exécutif ;
- d’une (1) personne du conseil syndical ;
- d’une (1) ou deux (2) personnes conseillères syndicales ;
- d’un-e (1) employé-e de bureau.
Comité de surveillance
Le comité de surveillance est formé de trois membres élus par le congrès du CCMM-CSN. Il doit se réunir au moins deux fois par année afin de procéder à la vérification des livres comptables et des états financiers. Il s’assure que le cadre budgétaire voté lors du congrès, de même que les décisions pouvant avoir un impact financier prises en assemblées générales ou en comité exécutif soient examinés.
Il fait rapport de ses observations au comité exécutif, à l’assemblée générale et au congrès.
Les membres du comité sont Adrien Doamba, Alain Guy Côté et Yves Duchesneau.
- Il fait rapport de ses observations au comité exécutif, à l’assemblée générale et au congrès.
- Les membres du comité sont Adrien Doamba, Alain Guy Côté et Yves Duchesneau.